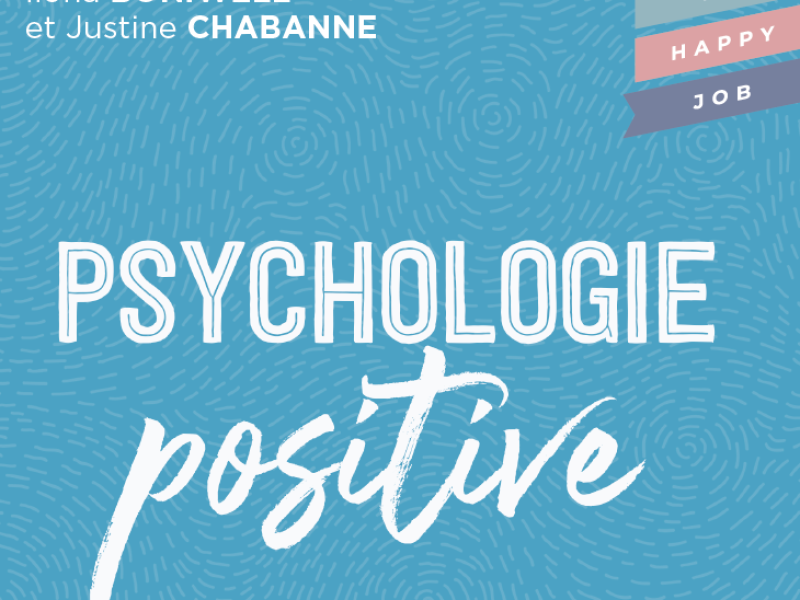Accueil > Expert praticien en psychologie positive au travail > Autrefois, une quarantaine formatrice par Philip Zimbardo
Autrefois, une quarantaine formatrice par Philip Zimbardo
Autrefois, une quarantaine formatrice par Philip Zimbardo
Témoignage saisissant d’un des psychologues les plus connus depuis l’expérience de la prison de Stanford et sur sa théorie sur le gestion du temps.


AUTREFOIS, UNE QUARANTAINE FORMATRICE PAR PHILIP ZIMBARDO ou comment développer des compétences de survie à l'âge de 5 ans
Par Philip Zimbardo
Lorsque j’avais 5 ans et demi et que je vivais à New York, j’ai développé une double pneumonie et la coqueluche. Il s’agissait dans les deux cas de maladies très contagieuses. J’étais un petit garçon fluet et la combinaison des deux faisait que je pouvais à peine respirer. Je luttais à chaque souffle.
Je vivais dans un immeuble, au sud du ghetto du Bronx, lorsqu’une ambulance est venue me chercher pour m’emmener loin de chez moi. À cette époque, tous les malheureux enfants atteints de maladie contagieuse devaient être mis en quarantaine dans un hôpital de la 16e rue de l’est Manhattan, appelé Willard Parker Hospital for Children with Contagious Diseases. Il s’agissait en fait d’une énorme base de quarantaine pour la tuberculose, la scarlatine, la coqueluche, la pneumonie et la polio (il y avait une épidémie de polio à cette époque). Il y avait des centaines d’enfants et de lits dans mon service.
Cette quarantaine a duré six mois, de novembre 1938 à avril 1939. À cette époque, il n’y avait ni pénicilline, ni sulfamides, ni traitement d’aucune sorte. Tout ce que je pouvais faire, c’était rester allongé dans mon lit, en attendant le sort qui m’était réservé. D’une certaine façon, je vivais un cauchemar quotidien, de jour comme de nuit.
Ce que je veux dire, c’est que, sans compter l’absence de tout traitement médical disponible, le personnel de l’hôpital n’avait même pas le sens le plus élémentaire de la prise en charge sociale ou émotionnelle des enfants. Je me contentais de rester allongé dans un lit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n’y avait ni radio, ni musique, ni télévision (celle-ci ne verra pas le jour avant 1947). Il n’y avait ni courrier, ni magazines, ni livres à colorier, ni téléphone et aucune possibilité d’exercice physique.
Les heures de visite étaient limitées à deux heures, le dimanche uniquement. En fait, ce n’était même pas le cas. Quand mes parents pouvaient venir à l’hôpital (ce qu’ils faisaient rarement car c’était très difficile), les infirmières faisaient rouler mon lit contre une grande fenêtre et je leur parlais au téléphone à travers une vitre. Mais dès qu’il y avait plus de trois lits qui attendaient derrière moi et que les parents suivants arrivaient, l’infirmière disait : “Ok, finissez. Vous devez partir.” Finalement, j’étais chanceux si j’avais eu au moins vingt minutes pour entretenir ce lien si précieux.
C’était un hiver froid à New York. Il fallait faire six pâtés de maisons à pied pour aller de chez moi au métro, puis une heure de trajet et enfin six pâtés de maisons, encore à pied, pour aller du métro à l’hôpital. À cette époque de l’année, les grosses tempêtes étaient fréquentes à New York. Ma mère était enceinte de ma sœur Vera. Mon frère George avait la polio et un appareil dentaire. Il y avait aussi mon petit frère Donny, de même pas deux ans, à trimballer. Il est évident que ma mère ne pouvait pas parcourir ces distances et mes parents ne pouvaient pas s’offrir les services d’un taxi, encore moins d’avoir leur propre téléphone. J’attendais toute la semaine cette heure magique mais personne ne venait, personne n’appelait. Très vite, j’ai appris que la clé de la survie est d’être autonome. Je ne pouvais pas compter sur les infirmières, je ne pouvais pas compter sur les médecins et je ne pouvais pas non plus compter sur ma propre famille pour m’aider dans ce terrible scénario.
En fait, j’ai décidé, très consciemment, que j’allais survivre. Je n’allais pas mourir – cela n’avait pas de sens pour moi de mourir alors que j’avais imaginé un long et merveilleux avenir devant moi. Alors qu’il faisait encore jour, à 20 heures, je ne pouvais pas dormir parce que je n’étais pas fatigué – après tout, je n’avais rien fait de la journée. Je me souviens encore, quand ils ont éteint les lumières et que les infirmières ont marché devant la lumière de leur bureau, ça a fait une ombre sur les murs, ce qui pour moi, à cet âge, était évidemment le diable qui venait faire son choix.
Je suis devenu très croyant. Le jour, je priais Jésus-Christ de me donner la force, la santé, le courage et de me permettre de survivre. La nuit, je priais le diable de ne pas me prendre. Je me disais que les chances de survie étaient double si on avait Dieu d’un côté et le diable de l’autre. J’aurais voulu dire au diable : “Regarde, il y a beaucoup d’autres enfants. Pourquoi moi ?” Plus tard, je me suis senti coupable de penser ça quand les enfants proches de mon lit sont morts – j’ai donc cessé de traiter avec le diable et j’ai laissé à Jésus le soin de faire un de ses miracles.
J’allais sous les couvertures et je priais ce vilain diable de ne pas me prendre parce que j’étais un bon garçon et que je ne méritais pas d’aller en enfer. Je n’ai réalisé que beaucoup, beaucoup plus tard que ce que je faisais était une forme primaire d’autohypnose, car quand je me réveillais, c’était le matin. Je ne faisais plus de cauchemars ; je me réveillerais simplement le lendemain pour me rendre compte avec joie que j’avais survécu à un autre jour (dans ma vie d’adulte, j’ai suivi une formation officielle en hypno thérapie et en autohypnose et je m’en suis souvent servi pour traiter les blessures et récupérer après diverses opérations chirurgicales).
Mon autre tactique de survie consistait à flatter les infirmières. Avant que je n’aille à l’hôpital, ma mère m’avait dit de me souvenir du vieux dicton selon lequel “on attrape plus de mouches avec du miel qu’avec du vinaigre”. Je n’ai pas vraiment compris ce qu’elle voulait dire, sauf qu’il valait mieux être une personne douce qu’une personne aigre. Il était clair que le fait de recevoir les bons soins de mes infirmières était essentiel pour ma réussite sociale et émotionnelle, j’ai donc appris à leur faire souvent des compliments. Elles portaient des masques tout le temps, alors je leur disais qu’elles avaient de beaux yeux ou de beaux cheveux, je faisais une remarque sur leurs boucles d’oreilles ou sur un bijou. Grâce à cela, j’espérais qu’elles se souviendraient de moi et que je recevrais une noisette de beurre en plus ou un dessert supplémentaire. Plus important encore, j’espérais qu’elles se souviendraient que j’étais assis sur le pot, car elles oubliaient souvent. Comme nous ne pouvions jamais sortir de nos lits, nous devions tous uriner et déféquer dans un pot, et parfois, l’infirmière nous oubliait ou il y avait une nouvelle infirmière de garde qui ne connaissait pas la situation. Alors c’était une décision consciente de ma part. Je me disais : “Tout le monde autour de moi est en train de mourir. Je ne veux pas mourir. Que puis-je faire de plus que de prier ?” Je me suis rendu compte que cette histoire de compliments était quelque chose que je devais faire souvent et bien.
Aujourd’hui encore, lorsque je parle de mon Heroic Imagination Project* (projet d’imagination héroïque – HIP), l’une des choses les plus importantes que je partage avec les stagiaires est : “Votre travail consiste à faire en sorte que les autres se sentent spéciaux. Apprenez leur nom, utilisez-le quand vous leur parlez, découvrez quelque chose d’important à leur sujet et faites-leur un compliment juste qui les feront se sentir spéciaux”. J’ai commencé à le faire à l’âge de cinq ans, après avoir réalisé que cela fonctionne comme une baguette magique.
Après avoir mis les infirmières, le diable et Dieu de mon côté, je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse autant avec les enfants autour de moi. La seule joie que nous avions était de lire des bandes dessinées de super-héros. En raison du caractère contagieux de la situation, les parents ne pouvaient pas nous donner de jouets ou quoi que ce soit de valeur. Ils étaient de toute façon pauvres, mais tout ce qui était apporté de valeur ne pouvait plus ressortir. Tout ce que nous avions, c’était ces bandes dessinées que nous partagions, dévorions et faisions circuler de lit en lit. Je ne savais pas lire à cette époque. Je regardais les images, je les trouvais belles, mais je devais demander à des enfants plus âgés de m’aider à lire les mots. J’ai demandé à ma mère de m’apporter un stylo et un bloc-notes pour que je puisse écrire chaque mot. Puis, un enfant plus âgé d’un lit voisin me disait ce que cela signifiait, comme “Ouah !” ou “Au secours !”. Je recopiais chaque lettre sur mon bloc-notes, puis je la prononçais à voix haute. Lorsque j’ai quitté l’hôpital, je savais lire et écrire de façon grossière avant même de commencer l’école l’année qui a suivi ma libération.
L’autre chose que j’ai réalisé quand j’étais à l’hôpital, c’est que j’avais besoin de faire quelque chose pour passer l’ennui. Après avoir lu la bande dessinée de Superman pour la dixième fois, qu’allais-je faire ? J’allais donc inventer des jeux d’équipe. Aux enfants qui étaient à portée de voix, je disais des choses comme : “Imaginez que nos lits sont des radeaux et que nous descendons le Nil à la recherche d’un alligator blanc”, et quelqu’un disait : “Ok, je ferai le guet” et un autre enfant disait : “Je tirerai sur n’importe quel animal sauvage”. Et nous prenions le large.
Concrètement, à partir de l’âge de cinq ans, j’ai commencé à assumer un rôle de leader, non pas parce que je voulais être un leader, mais parce que je m’ennuyais à mourir et que je voulais faire quelque chose d’intéressant. Il valait mieux jouer à être un leader que de suivre quelqu’un d’autre proposant des jeux sans intérêt. C’était une façon de m’amuser mais, en même temps, je me rendais compte de la puissance du groupe. Il fallait que quelqu’un se charge de nous faire avancer dans une direction intéressante tout en impliquant les enfants qui regardaient sans jouer. Pour ma part, ces dynamiques de groupe consistaient surtout à ne pas être seul et isolé, malgré la quarantaine. D’autres mouraient autour de moi, seuls dans leur lit. C’était ma petite tactique de résilience. Comment puis-je survivre, m’épanouir et profiter de ma présence ici tout en étant temporairement séparé de ma famille ?
J’écrivais, je dessinais et je jouais à ces jeux d’équipe. J’ai fini par cesser, littéralement, de penser à ma famille parce que cela me brisait le cœur. Même quand ils venaient, nous passions notre temps à pleurer. Il était préjudiciable de se réjouir de cette visite dominicale, car s’ils ne venaient pas, la peine était trop grande. Il valait mieux être agréablement surpris s’ils venaient ! Je pense que c’était une tactique de résilience primitive.
Une autre triste expérience était quand je me réveillais et que Billy ou Sally était parti, quand je demandais à l’infirmière “Où est parti Billy ?” et qu’elle me répondait “Billy est rentré chez lui”. Alors je demandais “Pourquoi n’a-t-il pas dit au revoir ?”, elle répondait quelque chose comme : “Eh bien, c’était la nuit et il ne voulait pas vous déranger, mais il m’a dit de vous saluer.” Puis la même chose se produisait avec un autre enfant, puis un autre.
Ce qui est intéressant, c’est qu’il y avait un accord tacite de déni entre les infirmières et nous, les enfants. Nous savions que “rentrer à la maison” signifiait qu’un enfant était mort, mais nous ne pouvions pas le dire parce qu’alors nous abandonnerions. Le problème était que la chose que nous voulions le plus au monde était de “rentrer à la maison”, mais nous ne voulions pas rentrer à la maison de cette manière ; nous voulions réellement rentrer à la maison.
Parfois, les enfants étaient vraiment libérés pour rentrer chez eux, youpi ! Je me souviens encore parfaitement lorsqu’une infirmière m’a dit : “Philip, tu vas rentrer chez toi”, je n’en étais pas tout à fait sûr. J’ai commencé par pleurer, mais mon infirmière préférée, Jenny, m’a dit qu’il était temps de sortir du lit parce que ma mère attendait en bas pour me ramener à la maison dans un vrai taxi. Je me souviens d’avoir enfin sauté du lit – et de m’être écroulé sur le sol. Tous mes muscles s’étaient atrophiés ! Pendant six mois, les enfants n’avaient même pas pu faire un minimum d’exercice dans leur lit pour conserver une certaine force musculaire. Il m’a fallu un mois ou plus avant de pouvoir marcher à nouveau. J’ai dû utiliser un fauteuil roulant en rentrant chez moi.
La dernière chose que je veux mentionner est la joie sans retenue que j’ai ressentie en retournant dans notre petit appartement de Prospect Avenue dans le Bronx. Ce qui m’a le plus surpris, c’est de voir dans le salon un sapin de Noël entièrement décoré – en avril ! Ses branches étaient brunes et tombantes, mais toujours couvertes de guirlandes et de rares ornements que ma mère avait conservés comme des trésors de famille. Pourquoi ? C’était la façon de ma mère Margaret d’affirmer sa conviction qu’un jour je reviendrais à la maison pour profiter d’un Noël tardif en famille, qu’importe quand ce moment viendrait. Cependant, mes frères détestaient cette idée – le sapin était devenu moche, prenait beaucoup de place dans notre petit salon et ils n’en comprenaient pas le sens. Mon père, George, et mes frères l’ont retiré le lendemain et tout fut bien qui finit bien.
Merci pour votre lecture de l'article : Autrefois, une quarantaine formatrice par Philip Zimbardo
Philip Zimbardo a été connu pour avoir mené la célèbre expérience de la prison de Stanford en 1971. Il est aussi témoin expert à Abu Ghraib. Son livre The Lucifer Effect explore la nature du mal. Dans ses nouvelles études, il étudie la nature de l’héroïsme.
Article écrit par Philip Zimbardo (traduit en français par Marianne Didier)
Découvrez en plus sur le projet de Philip Zimbardo : The Heroic Imagination : https://www.heroicimagination.org/
HIP conçoit des stratégies innovantes en combinant la recherche psychologique, l’éducation interventionnelle et l’activisme social pour créer des héros de tous les jours équipés pour résoudre des problèmes locaux et mondiaux.
Retrouvez Philip Zimbardo en mode vidéo TEDX
- Le bien et le mal
- Comment les gens ordinaires deviennent des monstres ou des héros
- La recommandation de Philip Zimbardo pour un rapport sain au temps
La CEO de Positran, le Pr Ilona Boniwell a travaillé avec Philip Zimbardo pour la gestion efficace du temps au travail. Retrouvez cette approche innovante sur le rapport au temps équilibré au travail dans le Module 6 du parcours Expert Praticien en Psychologie Positive Au Travail